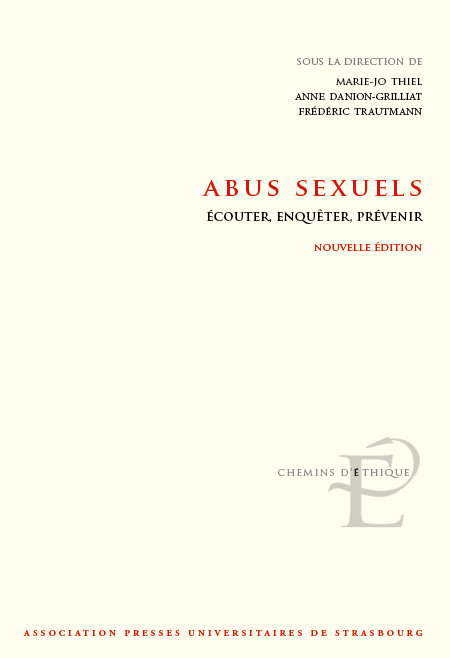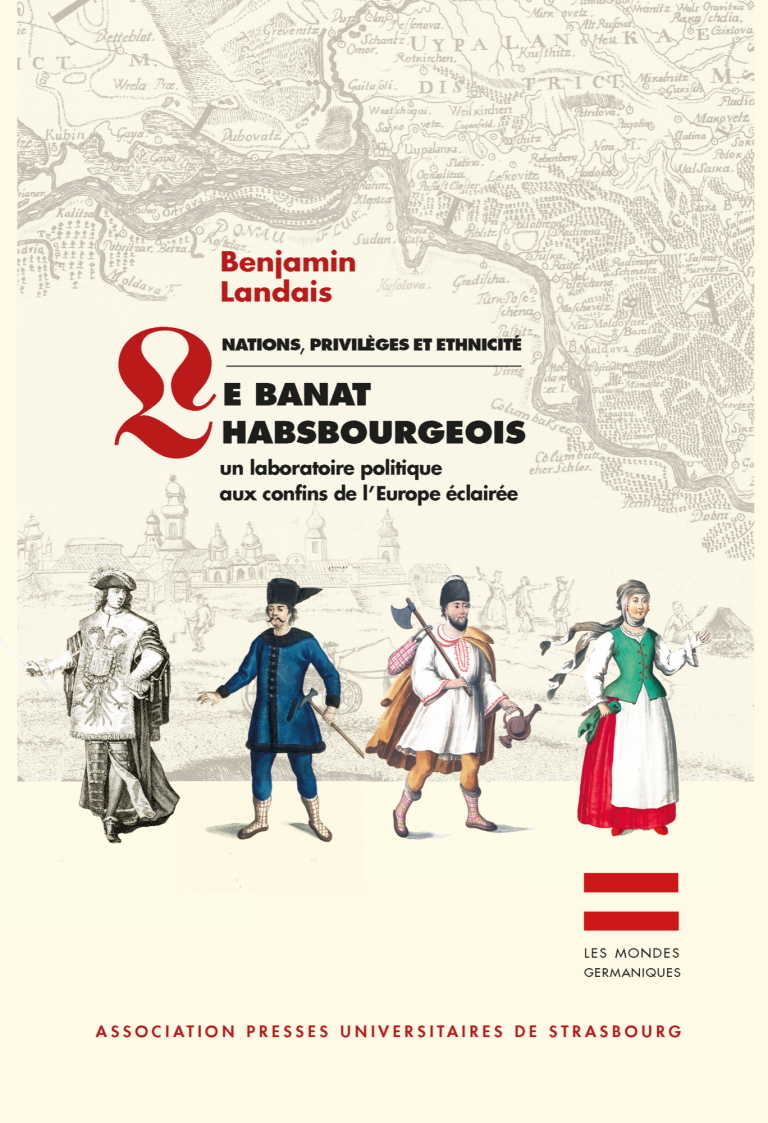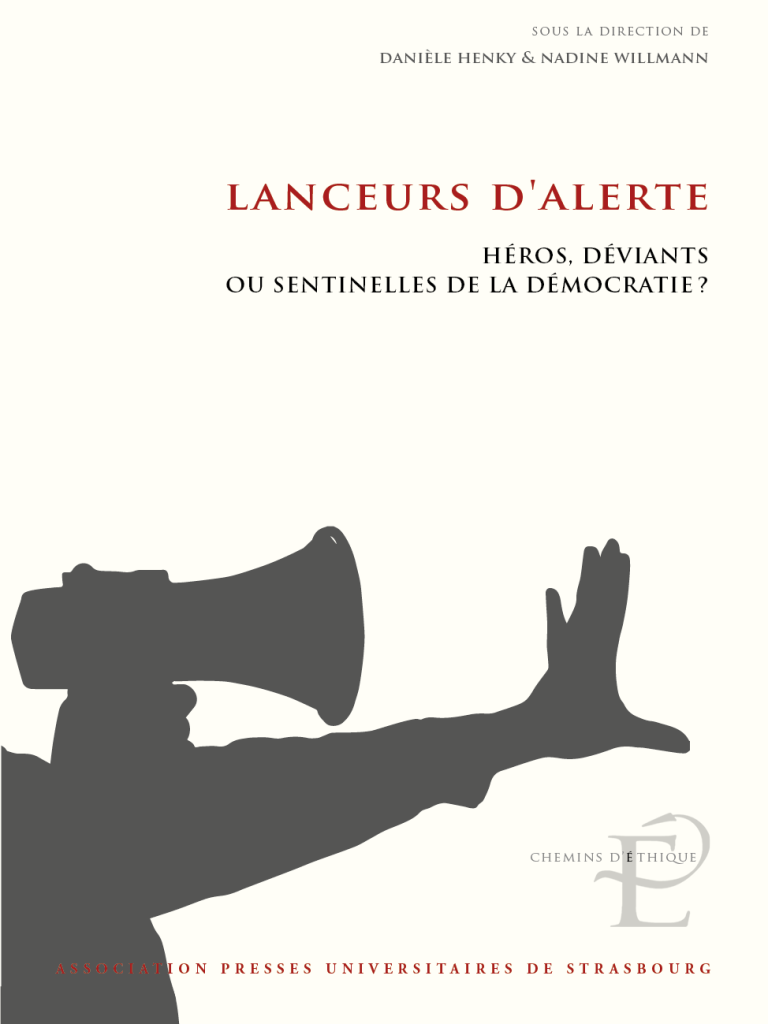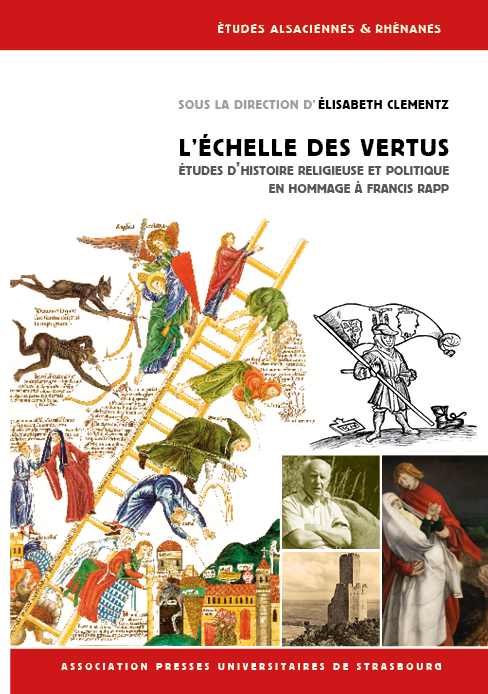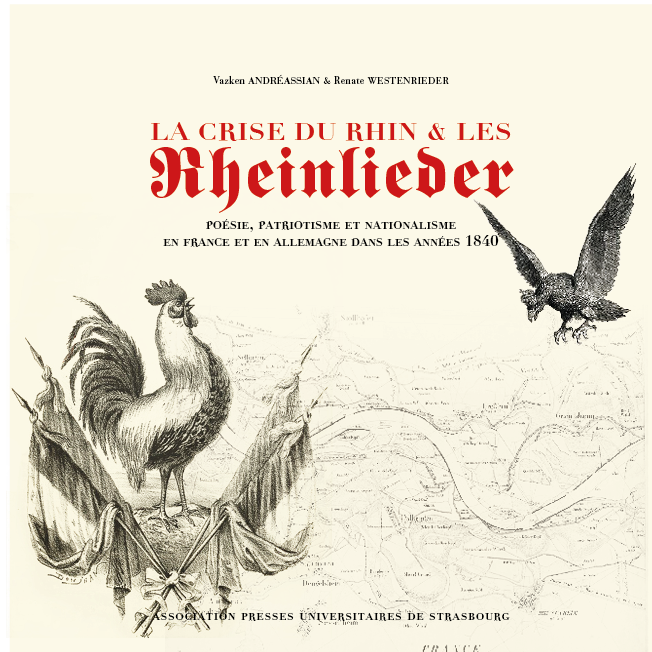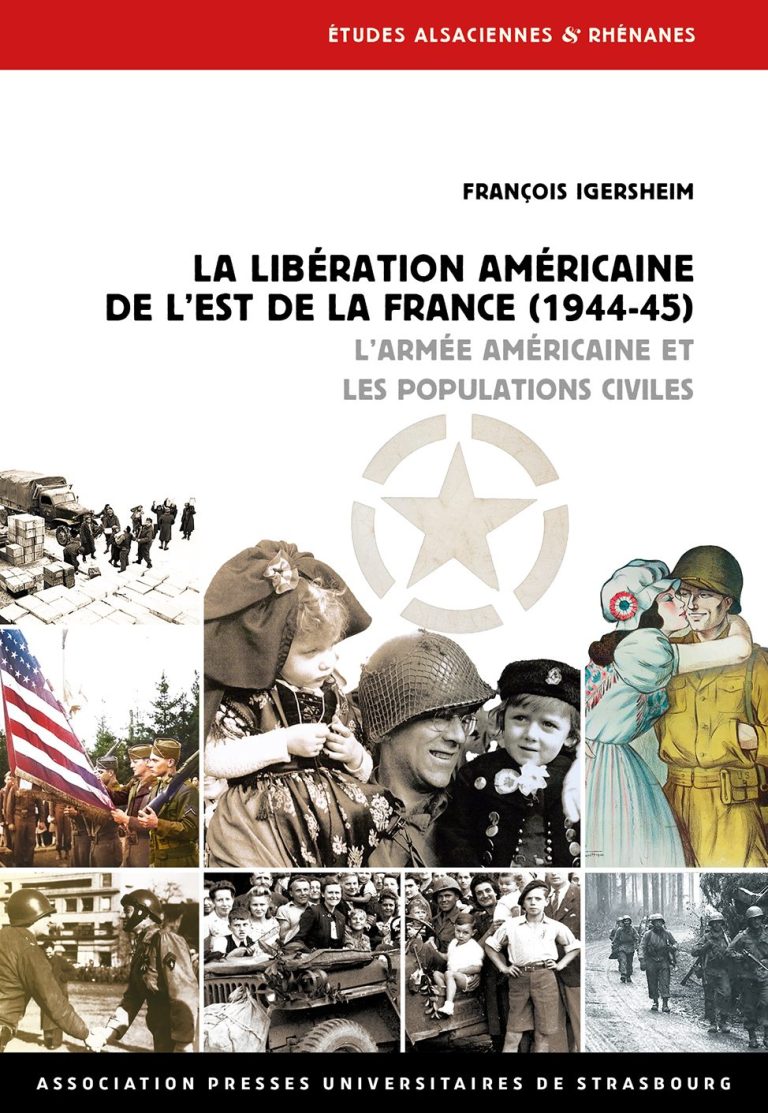DERNIÈRES PARUTIONS (2023/24)
Les titres récents de nos collections peuvent être directement commandés au bureau de l'Association en utilisant le formulaire figurant sous la présentation de chaque ouvrage
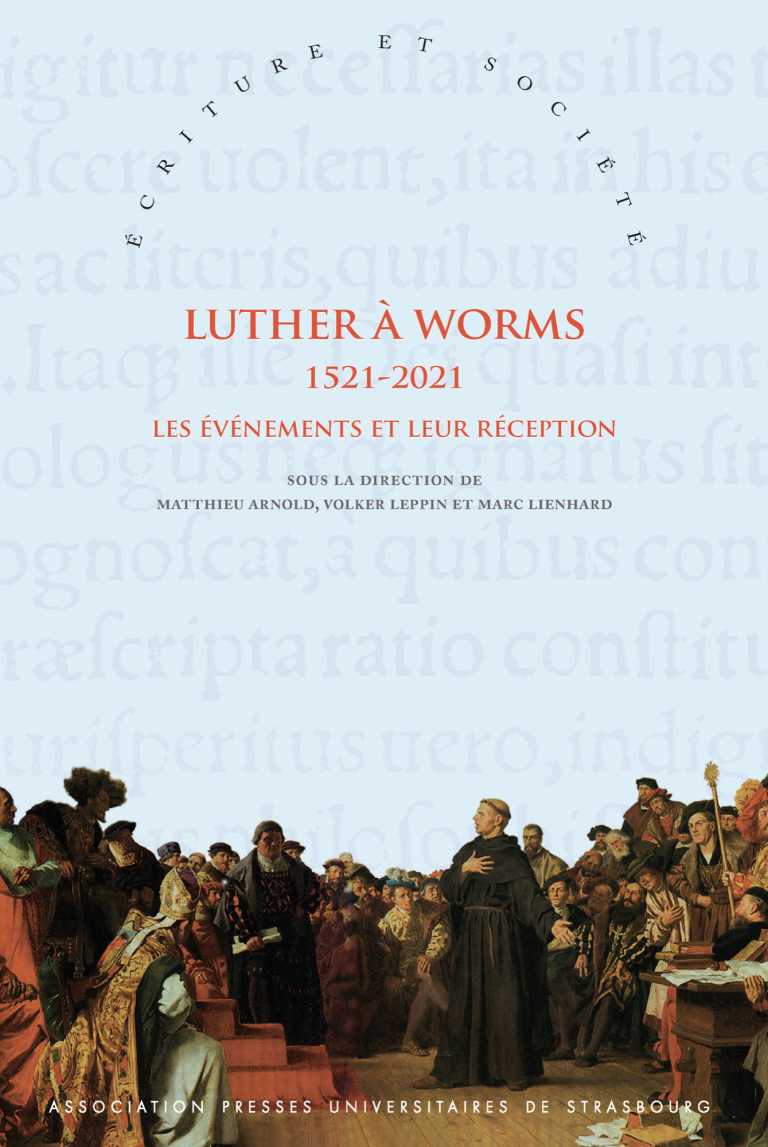
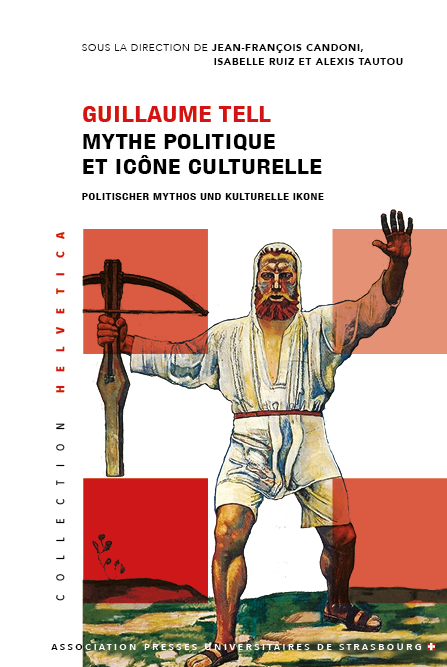
LUTHER À WORMS
1521-2021
LES ÉVÉNEMENTS ET LEUR RÉCEPTION
Sous la direction deMatthieu ARNOLD, Volker LEPPIN et Marc LIENHARD
Collection Écriture et société
276 pages, 32 illustrations
ISBN : 978-2-38571-002-6
Prix : 28 €
GUILLAUME TELL
MYTHE POLITIQUE ET ICÔNE CULTURELLE
POLITISCHER MYTHOS UND KULTURELLE IKONE
Sous la direction de Jean-François Candoni, Isabelle Ruiz et Alexis Tautou
Collection Helvetica
270 pages, 28 illustrations
ISBN : 978-2-38571-003-3
Prix : 28 €
ABUS SEXUEL
ÉCOUTER, ENQUÊTER, PRÉVENIR
nouvelle édition
Sous la direction de Marie-Jo Thiel, Anne Danion-Grilliat et Frédéric Trautmann
Collection Chemins d’éthique
448 pages
ISBN: 978-2-38571-000-2
Prix: 29,50 €
La comparution de Luther devant Charles Quint, les 17 et 18 avril 1521 à Worms, constitue l’un des deux événements emblématiques de la Réforme, avec la rédaction des 95 thèses « sur le pouvoir des indulgences ». Les deux événements sont étroitement liés : l’audition de Luther, lors de la diète de Worms, constitue l’épilogue de l’« affaire Luther » déclenchée par la contestation des indulgences.
La fameuse déclaration du Réformateur sur sa conscience, captive de la Parole de Dieu, puis la confession de Charles Quint, sont replacées dans leur contexte historique et théologique. Leur réception est étudiée dans la longue durée, depuis l’époque du Réformateur jusqu’au début du XXIe siècle.
Comme le montrent les onze contributions inédites de cet ouvrage, la comparution de Luther à Worms a alimenté la littérature la plus variée (écrits historiques et théologiques, correspondance, Propos de table, poésie, catéchèse, presse confessionnelle…) ; elle a été également célébrée dès ses débuts en images et, tout au long du xxe siècle, dans des films.
Contributions de : M. Arnold, R. Decot, Th. Dieter, J. Kampmann, M. Kessler, I. Klitzsch, V. Leppin, M. Lienhard, F. Muller, W.-F. Schaeufele et J. Schilling.
Guillaume Tell, héros helvète et emblématique, est avant tout une figure fictionnelle incarnant une constellation de valeurs. Valeurs éthiques, politiques ou idéologiques : Liberté, Nature, Démocratie… Guillaume Tell est ainsi reconnu comme l’icône archétypale d’une Suisse idéale, autrement dit un mythe d’origine dont l’efficacité importe davantage que la crédibilité.
De cette figure cultuelle, véritable et moderne Heiligenbild, il importait d’analyser les diverses représentations qui l’ont perpétuée et réactualisée, tout autant que les entreprises qui visent aujourd’hui à la déconstruire pour mieux en dévoiler les ressorts idéologiques.
Les quinze études qui composent cet ouvrage articulent ces deux approches. Elles montrent le contexte et les enjeux qui ont contribué à façonner une icône tour à tour libertaire, nationaliste, rebelle, paternaliste, républicaine ou chrétienne.
De Schiller à Max Frisch, les interprétations très contrastées de la figure totémique de Guillaume Tell confortent alors, mais de manière paradoxale, son statut de symbole. Tell n’est pas l’image consensuelle, neutre et naïve qu’on se figure habituellement. Tell est une icône composite à l’image d’une Suisse hybride et riche de ses contradictions.
Contributions de : Daniel Annen, Régine Battiston, Richard Blanchet, Jean-François Candoni, Gilles Darras, Yahia Elsaghe, Heide Hollmer, Charlotte Kurbjuhn, Gérard Laudin, Albert Meier, Thomas Nicklas, Silvio Raciti, Isabelle Ruiz, László V. Szabó, Alexis Tautou, Frédéric Teinturier, Andreas Wicke.
Cet ouvrage propose une étude approfondie sur la question des abus sexuels, de pouvoir et de conscience. Il traite également des
relations d’emprise, des abus psychologiques et spirituels qui leur sont connexes. Ces sujets sensibles sont analysés en amont et en aval, dans la société comme dans l’Église catholique. L’originalité de cette approche repose sur une large confrontation de points de vue interdisciplinaires et internationaux.
Contributions de : Gilles Berceville, Monique Berthelon, Caroline Bolla, Jacqueline Bouton, Mireille Cyr, Anne Danion-Grilliat, Mélina Douchy-Oudot, Thomas Dowd, Deidre Du Bois, Jean Ehret, Véronique Garnier, Anne Gindensperger, Stéphane Joulain, Martine Jungers, Gerhard Kruip, Elina Nitschelm, Alessandra Pozzo, Joël Pralong,
Jean-Georges Rohmer, Frédérique Riedlin, Julie Rolling, Muriel Salmona, Jean-Marc Sauvé, Gioia Scappucci, Eléonore Tergoresse, Marie-Jo Thiel,
Frédéric Trautmann, Drifa Wirrmann.
NATIONS, PRIVILÈGES ET ETHNICITÉ
LE BANAT HABSBOURGEOIS
UN LABORATOIRE POLITIQUE AUX CONFINS DE L'EUROPE ÉCLAIRÉE
Benjamin LANDAIS
Collection Les Mondes germaniques
580 pages, 98 illustrations
ISBN : 978-2-38571-007-1
Prix : 40 €
Partagé aujourd’hui entre Roumanie, Serbie et Hongrie, le Banat est l’une des régions d’Europe où la diversité ethnique est la plus importante. Cette situation trouve son origine au XVIIIe siècle dans des migrations massives, planifiées ou spontanées. Des dizaines de milliers de paysans catholiques de tous pays vinrent alors rejoindre les communautés orthodoxes qui peuplaient déjà les campagnes banataises. Complétant cette Babel rurale, des marchands grecs, arméniens et juifs s’installèrent également dans les bourgs et les villes.
Pour comprendre le passé de ce territoire mosaïque, situé entre monarchie habsbourgeoise et empire Ottoman, les catégorisations nationales rigides du présent sont de peu d’utilité. L’ethnicité doit être envisagée dans ses régimes d’historicité.
Cet ouvrage part ainsi d’une histoire intellectuelle des pratiques administratives. Il retrace l’appropriation politique du Banat par le pouvoir habsbourgeois, en insistant sur la tension entre gouvernements central et local. L’ethnicité n’est pas une classification savante imposée d’en haut dans une société coloniale. Les dynamiques du peuplement et la prolifération des privilèges collectifs, qui favorisent le morcellement identitaire, apparaissent à rebours de l’uniformisation souhaitée par les administrateurs viennois
Julien Assange, Edward Snowden ou Greta Thunberg ont rendu mondialement célèbre la figure du lanceur d’alerte appelant à un sursaut citoyen afin de protéger la Terre ou nos sociétés des nuisances et des dangers qui les menacent. La typologie de cette figure est cependant plus diverse qu’il y paraît. Si les alertes qu’on nous adresse aujourd’hui sont nombreuses et largement médiatisées, leur efficacité est contrastée et les interprétations qu’elles suscitent méritent réflexion.
Le propos de cet ouvrage y contribue de manière originale en adoptant, une approche plurielle du phénomène. Dix chercheurs de différentes disciplines analysent les qualités et les limites juridiques, humanistes ou éthiques des actions impulsées dans divers pays et domaines d´activité, et à diverses époques.
Ces contributions questionnent notamment la pertinence de ces entreprises au regard des enjeux de la démocratie ; elles s’interrogent aussi sur l´opportunité de considérer ces whistleblowers comme des héros ou comme des déviants …
Contributions de : Jacqueline Bouton, Isabelle Rachel Casta, Elena Di Pede, Olivier Hanse, Danièle Henky, Jean Jauniaux, Florence Louis, Jules Samson Nyobe, Anne-Marie Pailhès, Edouard Schalchli, Nadine Willmann.
LANCEURS D'ALERTE
HÉROS, DÉVIANTS OU SENTINELLES DE LA DÉMOCRATIE?
Sous la direction de Danièle HENKY
et Nadine WILLMANN
Collection Chemins d'éthique
180 pages
ISBN : 978-2-38571-005-7
Prix : 24 €
L'ÉCHELLE DES VERTUS
ÉTUDES D'HISTOIRE RELIGIEUSE ET POLITIQUE EN HOMMAGE À FRANCIS RAPP
Sous la direction d'Élisabeth CLEMENTZ
Collection Études alsaciennes et rhénanes
306 pages, 39 illustrations
ISBN : 978-2-38571-004-0
Prix : 28,50 €
Cet ouvrage recueille des recherches menées dans le sillage des travaux de Francis Rapp.
Les études alsatiques y sont naturellement conséquentes : les recluses du XIIe au XV e siècle, les nécrologes et obituaires de la fin du Moyen Âge, les diverses formes de vie religieuse accessibles aux femmes à Strasbourg à la même époque, les revenus des prébendiers de la cathédrale de Strasbourg vers 1516, une interprétation nouvelle du retable d’Issenheim, la culture politique des insurgés de 1525, les «chevaliers brigands » et leurs châteaux au xv e siècle, les rapports des clercs avec les militaires au XVIIIe siècle.
Mais il est aussi question de la réforme de l’Église telle que l’a insufflée le pape Léon IX (au demeurant d’origine alsacienne), de la place de la Vierge et des saints dans les pèlerinages français de la fin du Moyen Âge, et de la prédication comme forme de communication de masse, telle que l’avait déjà envisagée Francis Rapp.
Contributions de : Nicole Bériou, Georges Bischoff, Élisabeth Clementz, Benoît Jordan, Rolf Große, Sigrid Hirbodian, Marc Lienhard, Philippe Lorentz, Bernhard Metz, Claude Muller, Anne Rauner, André Vauchez, Catherine Vincent.
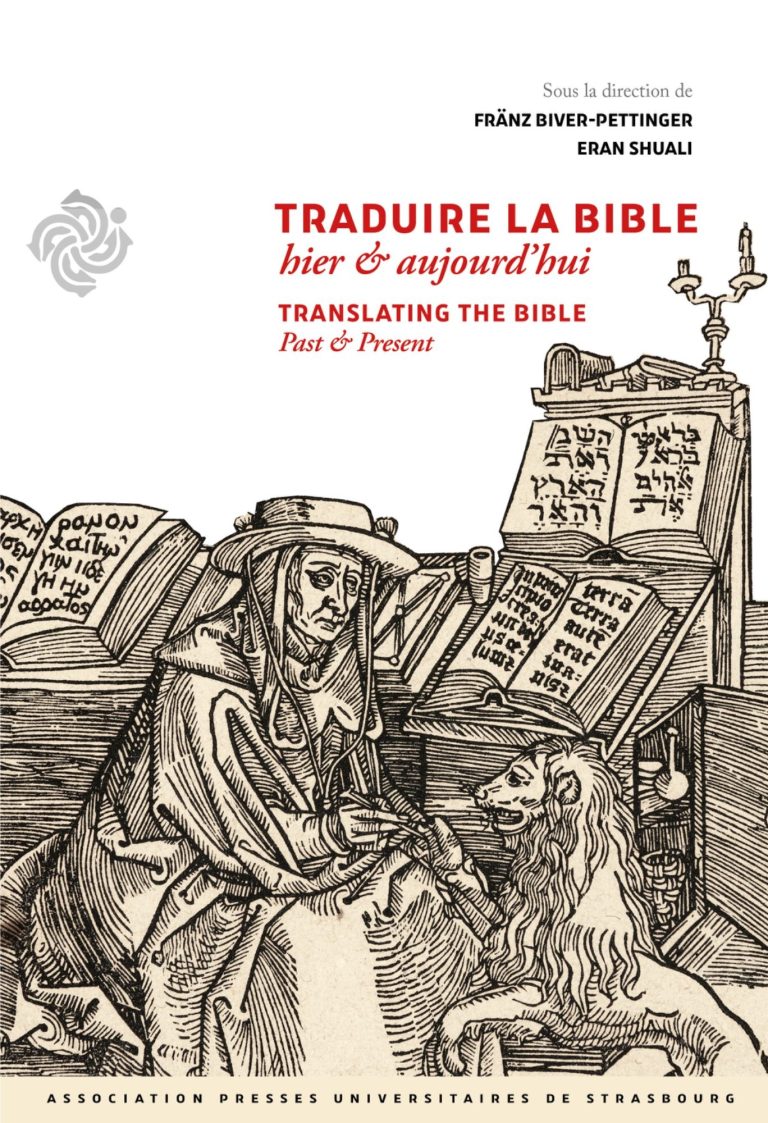
LA LIBÉRATION AMÉRICAINE DE L'EST DE LA FRANCE (1944-45)
L'ARMÉE AMÉRICAINE ET LES POPULATIONS CIVILES
François IGERSHEIM
Collection Études alsaciennes et rhénanes
362 pages, 80 illustrations
ISBN : 978-2-38571-011-8
Prix : 40 €
Retraçant les étapes de la « Libération américaine de l’Est de la France » dans le sillage de la 7e armée américaine, cette étude révèle toute la complexité d’une campagne militaire qui doit prendre en charge la gestion des troupes comme celle de populations civiles démunies ou désorganisées.
On y découvre le rôle essentiel joué par les officiers américains Civil affairs en collaboration avec les officiers de liaison et les FFI français : assurer la coexistence des soldats et des civils, régler les problèmes de logement et de ravitaillement, restaurer l’administration, les équipements ou les voies de circulation. Mais il faut aussi organiser les conditions d’une vie économique minimale, créer des emplois ou résoudre des problèmes financiers et monétaires.
D’août 1944 à mars 1945, cette entreprise, préparée de longue date, est mise à rude épreuve par les aléas des combats, les difficultés climatiques et les différences géopolitiques des régions traversées. Rien de commun en effet entre les départements à l’Ouest des Vosges et les territoires annexés. Le cas de l’Alsace, et notamment celui de Strasbourg et Colmar, font ainsi l’objet d’une analyse plus approfondie.
Loin des clichés d’une période joyeuse et ensoleillée, cet ouvrage, rigoureusement étayé par de nombreuses archives officielles, apporte un éclairage inédit sur ce qu’a été la libération de la France.
TRADUIRE LA BIBLE
HIER & AUJOURD'HUI
TRANSLATING THE BIBLE
PAST & PRESENT
Sous la direction de Fränz Biver-Pettinger
et d'Eran Shuali
Collection du CERIT
447 pages, 50 illustrations
ISBN : 978-2-38571-008-8
Prix : 40 €
C'est par une traduction que la plupart des lecteurs de la Bible appréhendent cette œuvre fondamentale pour nos religions et nos cultures.
Il en est ainsi depuis deux millénaires.
Mais comment (peut-on ou doit-on) traduire la Bible ? Sur quel(s) texte(s) se fonde-t-on ? Quel(s) type(s) de langage emploie-t-on ? Quels effets cherche-t-on à produire ? À quelles difficultés se heurte-t-on ? À toutes ces questions, une vingtaine de spécialistes tentent ici d’apporter des réponses au regard des traductions d’hier et d’aujourd’hui.
La première partie de cet ouvrage est consacrée à l’histoire des traductions de la Bible : la Septante ; les écrits de Qumrân ; les traductions médiévales du Nouveau Testament en arabe, en catalan et en hébreu ; l’histoire des traductions françaises au Moyen Âge et dans la Modernité ; les traductions en russe et en grec moderne ; les débats entre catholiques et protestants ; les premières traductions féministes de la Bible.
La seconde partie donne la parole aux traducteurs d’aujourd’hui : la traduction de la Septante en grec moderne ; celle du Nouveau Testament en hébreu moderne, de la Bible en sango, des évangiles en luxembourgeois ; la dernière révision de la Bible allemande de Luther ; deux traductions en anglais ; trois traductions récentes en français.
LA CRISE DU RHIN ET LES RHEINLIEDER
POÉSIE, PATRIOTISME ET NATIONALISME EN FRANCE ET EN ALLEMAGNE DANS LES ANNÉES 1840
Vazken Andreassian et Renate Westenrieder
Collection Études alsaciennes et rhénanes
186 pages, 136 illustrations I
ISBN : 978-2-38571-006-4
Prix : 39 €
La Crise du Rhin est l’histoire d’une guerre méconnue entre la France et l’Allemagne où des régiments de poètes se sont affrontés, la plume à la main, et s’envoyant des vers au visage.
En 1840, la France, menaçant de s’emparer de la rive gauche du Rhin, suscita l’indignation de nombreux poètes allemands dont les rimes belliqueuses allaient façonner durablement l’imaginaire du nationalisme germanique. En retour, les meilleures plumes françaises (dont Lamartine et Musset) se jettèrent dans la bataille, compromettant leur talent en quatrains agressifs, plus patriotiques qu’ épiques.
Ces échanges littéraires singuliers ne constituent pas seulement une étape importante de la montée des nationalismes, ils contribuent également à l’essor d’un genre - celui des rheinlieder - comme au renouveau de la mythologie rhénane où la figure allégorique du fleuve frontalier
oscille entre hédonisme et héroïsme.
Cet ouvrage documente le contexte historique dans lequel s’inscrit
cette vogue des Rheinlieder.
Il propose surtout une véritable
anthologie des poèmes écrits à l’occasion
de la Crise du Rhin. Beaucoup sont inédits
et traduits ici pour la première fois.
© Copyright. Tous droits réservés.
Nous avons besoin de votre consentement pour charger les traductions
Nous utilisons un service tiers pour traduire le contenu du site web qui peut collecter des données sur votre activité. Veuillez consulter les détails dans la politique de confidentialité et accepter le service pour voir les traductions.